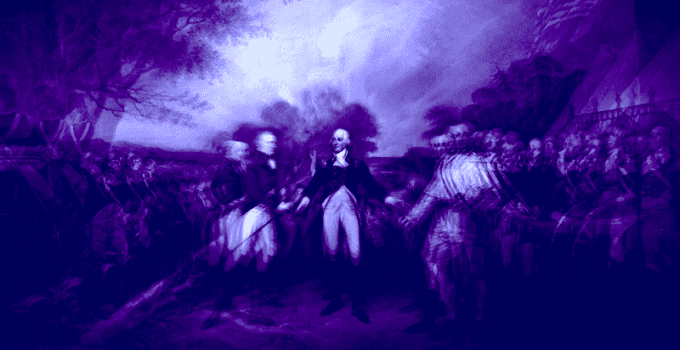Les théories du complot : de la répression de l’innovation extraterrestre à la naissance de la nation américaine
Assis à ma table de cuisine, un ami libéral diplômé d’un collège m’a récemment révélé un secret : l’industrie des combustibles fossiles réprime une technologie extraterrestre qui pourrait éliminer notre besoin de brûler du pétrole et du gaz. Cette révélation n’est qu’une parmi de nombreuses histoires étranges circulant sur les réseaux sociaux. Des lasers spatiaux juifs aux puces dans les vaccins, les théories du complot semblent avoir pris le dessus.
Les vues de Robert Kennedy Jr. sont en hausse alors que la réputation des responsables de la santé publique, longtemps considérés comme des fonctionnaires sérieux mais plutôt ennuyeux, est en chute libre. Même les météorologues, ces experts bienveillants qui vous suggèrent de prendre un imperméable pour votre sortie du week-end, ont récemment reçu des menaces de mort pour avoir « dirigé » des ouragans pour nuire à leurs ennemis politiques.
La théorie du complot : un pilier de l’histoire américaine
Cependant, avant de prédire la disparition imminente de la raison et du bon sens, considérons qu’il est toujours temps de conspiration en Amérique. Les États-Unis ont en effet été fondés sur la curieuse croyance que le roi George III et ses méchants acolytes avaient l’intention d’asservir les Américains. « Tu étais mien à soumettre », chante la sinistre tête couronnée dans la comédie musicale Hamilton.
Les ennuis ont commencé en 1765, lorsque la Grande-Bretagne cherchait à résoudre son déficit budgétaire après la coûteuse guerre de Sept Ans qui avait défendu l’Amérique britannique contre ses ennemis. Imposer une petite taxe sur le papier, les timbres et autres produits importés dans les colonies semblait être un moyen simple de faire participer les Américains à l’effort financier. Cependant, de nombreux colons considéraient l’Acte du timbre comme une tentative de forces obscures d’imposer une tyrannie absolue. Henry Laurens, de Caroline du Sud, fulminait contre « un vilain malveillant agissant derrière le rideau » du gouvernement britannique.
C’était une affirmation qui a gagné en popularité. Cinq ans plus tard, un orateur lors d’une réunion municipale de Boston déclara qu’un « plan désespéré de despotisme impérial avait été élaboré et partiellement mis en œuvre pour l’extinction de toute liberté civile ». En 1773, le gouverneur du Massachusetts, Thomas Hutchison, se lamentait sur les « hommes artificieux et calculateurs » qui avaient convaincu un public crédule que le gouvernement britannique avait l’intention d’asservir les colons nord-américains.
Les racines de la Révolution américaine
À la veille du conflit, de nombreux Américains croyaient que l’empire était dirigé par un groupe secret qui avait l’intention de mettre les Américains blancs en esclavage. Le planteur de Virginie George Washington a averti que les puissants de Londres avaient l’intention de faire des colons des « esclaves dociles et abjects, tout comme les Noirs que nous gouvernons avec un pouvoir arbitraire ». Alexander Hamilton était d’accord pour dire qu’un « système d’esclavage » était en train d’être « mis en place contre l’Amérique ».
Thomas Jefferson a également critiqué le « plan délibéré et systématique de nous réduire en esclavage ». Sa célèbre déclaration affirme que la Grande-Bretagne, après avoir commis « des injures et usurpations répétées », avait l’intention d’imposer « une tyrannie absolue » sur les treize colonies. Le document fondateur de la nation n’est rien de moins qu’une tentative de convaincre le monde d’une théorie du complot douteuse. C’était une théorie qui, comme l’écrit l’historien Bernard Bailyn, « était au cœur du mouvement révolutionnaire ».
La réalité derrière les théories du complot
Cependant, il n’existait aucun « plan systématique ». La Grande-Bretagne avait une monarchie constitutionnelle limitant strictement le pouvoir de George III, un Parlement élu qui détenait les cordons de la bourse de l’empire, et une tradition juridique offrant un minimum de droits aux citoyens. La presse britannique était la plus vive et irrévérencieuse du continent, et dans le monde clos des élites londoniennes, les secrets étaient difficiles à garder.
Les chercheurs révolutionnaires, groupe notoirement disputé, sont unanimes pour conclure que la métropole n’avait aucune intention de réduire les Américains blancs au même statut que les millions d’Africains qu’ils détenaient en esclavage. « La conspiration n’existait pas, mais les colons croyaient sincèrement qu’elle existait », note le chercheur en conspiration Michael Butter. Même l’historien Jon Kukla, qui sympathise avec les préoccupations des colons et est sceptique quant aux affirmations britanniques, conclut que les craintes de « l’esclavage de type servile pour les Américains blancs étaient hyperboliques ».
Les origines de la Révolution américaine
Bien sûr, les personnes autochtones ou esclaves vivant sous l’Union Jack avaient de bonnes raisons de se révolter. Les terres des premières étaient menacées par les colons, tandis que les derniers enduraient la servitude à vie. Les colons blancs, en revanche, bénéficiaient de nombreux des mêmes droits et privilèges que ceux vivant en Grande-Bretagne. Lorsque les Américains ont protesté contre l’Acte du timbre, par exemple, le Parlement l’a abrogé. Comparée à celles de l’Espagne et de la France, selon un autre universitaire, « l’empire britannique semblait doux ».
La plupart des colons de l’époque se considéraient comme des Whigs, membres du mouvement politique britannique qui se targuait de soutenir la tranquillité intérieure tout en défendant les droits individuels (bien que ceux-ci n’incluaient pas les Noirs, les Indiens ou les Catholiques). Les Whigs ne pouvaient justifier une révolte, note l’historien George H. Smith, que s’il s’agissait de prévenir « un plan global d’établir le despotisme » plutôt que de « simples événements isolés et sans rapport ». Pourtant, les Américains avaient des assemblées législatives élues, un faible taux d’imposition et une disparité beaucoup moins importante de richesse qu’en Europe. Philadelphie en 1776 n’était guère Paris en 1789 ou Saint-Pétersbourg en 1917.
La puissance de la propagande et des complots politiques
Tout comme les réseaux sociaux d’aujourd’hui, les pamphlets et les journaux étaient alors nouvellement disponibles à grande échelle et lus avec enthousiasme. Ceux qui croyaient en la perfidie d’Albion – ou qui l’exagéraient pour leur propre avantage – utilisaient habilement ces nouveaux outils. En tête des « hommes artificieux et calculateurs » de Hutchison se trouvait Samuel Adams du Massachusetts. « Nous ne pouvons pas créer d’événements », a-t-il déclaré un jour. « Notre travail est de les améliorer de manière avisée. » Adams a forgé une histoire captivante qui « améliorait » la réalité plus chaotique de la politique transatlantique, créant ce que nous pourrions appeler aujourd’hui des « faits alternatifs ».
Les dirigeants patriotes de la Nouvelle-Angleterre, tels que John Hancock, étaient souvent des marchands qui tiraient profit de la contrebande et qui étaient mécontents des restrictions britanniques sur leur commerce. L’arrivée de navires et de troupes britanniques après la Boston Tea Party de fin 1773 attisait le ressentiment parmi les petits agriculteurs de la région. Il n’était pas trop difficile de les inciter à soutenir la « Cause glorieuse ».
Les fausses croyances et la naissance d’une nation
La situation au sud était cependant très différente. En Virginie, la plus ancienne, la plus grande, la plus riche et la plus peuplée des colonies, ce sont les planteurs d’élite qui menaient l’opposition à la Grande-Bretagne. Ils étaient mécontents du refus du roi de leur accorder des terres indigènes à l’ouest des Appalaches, une interdiction mise en place pour éviter une guerre coûteuse avec les Indiens. Ils étaient également lourdement endettés envers les commerçants écossais et craignaient que la poursuite de l’importation d’esclaves ne fasse baisser la valeur de leur propriété humaine. Faire partie de l’Empire britannique était mauvais pour les affaires.
Ces préoccupations étaient de peu d’intérêt pour les petits agriculteurs de Virginie qui composaient la majorité de la population blanche. La plupart n’avaient jamais vu de soldats en uniforme rouge, préféraient le cidre fait maison au thé et se souciaient peu de la spéculation foncière. Pourtant, leur soutien était essentiel dans tout affrontement avec la Grande-Bretagne. Ensuite, le gouverneur royal, Lord Dunmore, confisqua les stocks de poudre de l’Arsenal au cœur de la capitale de Williamsburg en avril 1775, pour prévenir une rébellion armée dans sa colonie.
L’avocat de campagne et orateur doué Patrick Henry saisit cette opportunité. Henry savait qu’un différend obscur sur le thé et les tarifs n’inspirerait pas la masse des Virginie
ns blancs à défier l’empire le plus puissant du monde. « Ces choses ne les affecteront pas », expliqua-t-il à un ami ce mois-là. « Ils dépendent de principes trop abstraits pour leur compréhension et leur ressenti. Mais parlez-leur du vol de l’Arsenal, et que l’étape suivante sera de les désarmer », écrivit-il. « Vous ramenez le sujet à leurs cœurs, et ils seront prêts à prendre les armes pour se défendre. »
Les conséquences des complots politiques
Derrière les habiles Adams et charismatique Henry se trouvaient des dizaines de rédacteurs en chef de journaux sympathisants de la cause patriote et désireux de propager la propagande anti-britannique. Les propriétaires des quatre journaux de Virginie étaient tous de fervents patriotes, et ils travaillaient sans relâche pour influencer un public qui restait largement sur la clôture.
De nombreux New-Yorkais, quant à eux, n’étaient pas enthousiastes à l’idée de s’opposer à la Grande-Bretagne. En mai 1775, une foule en colère du Connecticut a saccagé un journal jugé trop favorable aux loyalistes ; le plomb a été fondu en balles. Au cours de l’année qui a suivi, la Grande Conspiration est devenue virale, la Déclaration d’indépendance a été adoptée, et l’ennemi juré de la Grande-Bretagne, la France catholique, est intervenue pour fournir un soutien financier et militaire crucial aux rebelles. Une nation est née.
Les leçons de l’histoire
Lorsque la guerre a été gagnée, l’amour américain pour les complots n’a pas disparu. Même Washington, le citoyen le plus adulé et respecté du pays, s’est avéré vulnérable à leur pouvoir. Dans les années qui ont suivi le conflit, l’ancien général et les anciens officiers de l’armée continentale ont formé la Société de Cincinnati, un groupe caritatif nommé d’après un officier romain qui s’était retiré dans sa ferme. L’adhésion à ce groupe d’élite devait se transmettre de père en fils.
L’organisation a immédiatement été attaquée comme un gouvernement militaire de l’ombre aux prétentions aristocratiques. John Adams l’a qualifiée de « pièce de ruse la plus profonde jamais tentée », tandis que le politicien du Massachusetts Elbridge Gerry – qui nous a donné le terme « gerrymander » – s’est insurgé contre « ce loup politique » déguisé « en agneau ». Mis sur la défensive, un Washington agité a dû modifier les statuts de la société pour calmer la controverse.
Few scholars today credit the concerns raised by Adams and Gerry, but their influence was sufficient to threaten plans to adopt the new Constitution in 1787. Washington, who presided over the Philadelphia convention, unhappily reported there were those “hardy enough to assert that the proposed general government was the wicked and traitorous fabrication of the Cincinnati.”
The new government eventually was approved, and the society’s threat never materialized. But in subsequent decades and centuries, others would take its place. A parade of Freemasons, Mormons, Jews, Abolitionists, Anarchists, Communists, and Muslims would later be seen as antithetical to the nation or its way of life. In the 1850s, the anti-Catholic Know Nothing party feared that the pope intended to use Irish immigrants to take over the country, and even stole the stone that Pope Pious IX had sent to incorporate into the Washington Monument.
“In America, it is always a paranoid time,” says conspiracy researcher Jesse Walker. Real dangers, of course, always exist; as the saying goes, just because you are paranoid doesn’t mean someone isn’t out to get you. British redcoats attacked colonists, anarchists set off bombs, a right-wing nationalist blew up a federal building, and Muslim fundamentalists destroyed the Twin Towers. Yet, too often, popular conspiracy theories masked simple intolerance and ended in harsh persecution of innocent citizens cynically manipulated by political leaders.
Are we doomed to repeat this cycle? Researchers say that conspiracies proliferate when Americans struggle with growing inequality, increased immigration, and a proliferating distrust of elites. If they are correct, it is not hard to see why there is an upswing in contemporary conspiracies. Butter argues that we are, in fact, emerging from a lull, and “returning toward that position of importance that they occupied throughout most of American history.”
Today, Americans are coming full circle, with Washington bureaucrats standing in for the British ministers of 250 years ago. The view that the federal government is run by a “Deep State” is simply the latest version of the “malicious villain acting behind the curtain” popularized in colonial times. If we take history as our guide, the sole tonic for curing ourselves and our leaders of our destructive delusions is to create a more just and equitable society. That is just the sort of nation that our founders, despite the false conspiracy they embraced, had the foresight to envision.
__________________________________
A Perfect Frenzy: A Royal Governor, His Black Allies, and the Crisis That Spurred the American Revolution par Andrew Lawler est disponible auprès de Atlantic Monthly Press, une marque de Grove Atlantic.